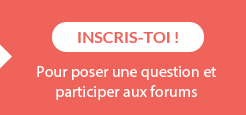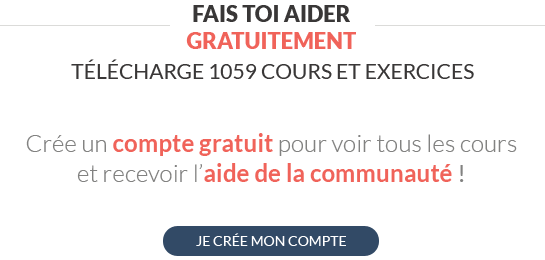Inscription / Connexion Nouveau Sujet
[Activité documentaire] Nucléaire
Bonjour à tous,
J'ai une activité de découverte et j'aimerais de l'aide sur certaines questions :
D'accord je vous remercie, voici le texte :
Activité documentaire : Approche historique de la radioactivité naturelle et de la radioactivité artificielle
La radioactivité naturelle
En 1895, la structure de l'atome est loin d'être connue. Toute transmutation (c'est-à-dire la transformation d'un élément chimique en un autre) semble impossible, les éléments sont immuables. Wilhelm Röntgen met alors en évidence l'existence d'un nouveau type de rayonnement capable de traverser d'importantes épaisseurs de matière : les rayons X. Cette découverte, qui marque la naissance de la radiologie, a eu un énorme retentissement à l'époque. A la suite de la découverte des rayons X en 1845, les scientifiques multiplient les expériences et découvrent des phénomènes nouveaux qu'ils nomment radioactivité naturelle et artificielle. Avec le polonium et le radium, Pierre et Marie Curie avaient montré que les rayons uraniques étaient bien autre chose que des rayons attachés à l'uranium. Mais on ignore encore tout de la nature de ces rayons. De quoi sont-ils faits ? Quelles sont leurs propriétés ? Les questions relatives aux propriétés des rayonnements mobilisent les physiciens, Rutherford et Soddy en Angleterre, mais aussi Becquerel, les Curie, Villard et d'autres. La contribution d'un jeune physicien néo-zélandais qui vient de terminer sa thèse à Cambridge, Ernest Rutherford va s'avérer déterminante. Ayant étudié l'absorption des rayonnements dans un empilement de très minces feuilles d'aluminium, il conclut dès janvier 1899 que le rayonnement est complexe. Le rayonnement de l'uranium comporte au moins deux types distincts de rayonnements : l'un qui est très facilement absorbé et que l'on dénommera par commodité le rayonnement alpha, et l'autre de caractère plus pénétrant qui sera dénommé rayonnement bêta. Dès lors, les expériences, parfois contradictoires, se succèdent. Elles sont menées notamment par le chimiste F.Giesel en Allemagne, par les physiciens Stéfan Meyer et E. von Schweidler à Vienne, également par H. Becquerel, qui revient à l'étude des corps radioactifs fin mars 1899 et bien sûr aussi par Pierre et Marie Curie. Ces derniers mettent aussi en évidence, en novembre 1899, deux types de rayonnement à partir du radium. Les appareillages se sont perfectionnés. On soumet les rayons à l'action d'aimants puissants. On observe que ces aimants dévient en sens inverse les rayons alpha et bêta. C'est la preuve que ces rayons sont composés de particules, animées d'une grande vitesse et porteuses d'une charge électrique. Il ne s'agit pas de rayons X. Les expériences mettent rapidement en évidence que le rayonnement bêta le plus pénétrant est composé d'électrons de grande énergie. Quant au rayonnement alpha, c'est Rutherford qui en élucidera la nature ; d'abord particule massive en 1902, puis atome d'hélium complètement ionisé en 1907, enfin noyau d'hélium après sa découverte d'un noyau dans l'atome. Indépendamment, en avril 1900, Paul Villard, du laboratoire de chimie à de l'École Normale Supérieure, rapporte qu'il existe aussi, dans le rayonnement du radium, des rayons « non déviables », mais très pénétrants. Ce troisième type de rayons des corps radioactifs recevra le nom de rayons gamma. Le rayonnement gamma est de même nature que les rayons X, mais de plus grande énergie (et donc de plus petite longueur d'onde).
La radioactivité artificielle
Le physicien anglais Ernest Rutherford avait réalisé dès 1919 la première « transmutation artificielle » de matière en bombardant de l'azote avec des noyaux d'hélium, mais les atomes d'oxygène obtenus étaient stables. Une question pouvait se poser : en bombardant un noyau d'atome stable avec des projectiles «adaptés», verra-t-on apparaître un nouveau noyau radioactif, un noyau radioactif artificiel ? La réponse a été positive. On parle alors de radioactivité artificielle, une radioactivité de noyaux fabriqués par une technique humaine. C'est Irène et Frédéric Joliot-Curie qui l'ont découverte. L'expérience d'Irène et Frédéric Joliot-Curie En bombardant une feuille d'aluminium avec des noyaux d'hélium (rayonnement ? du polonium), Irène et Frédéric Joliot-Curie observent que des neutrons et des électrons positifs sortent de la feuille. Quand ils retirent la source de rayonnement ?, l'émission de neutrons cesse mais l'émission d'électrons positifs continue en diminuant dans le temps.
Que s'est-il passé ? Il y a eu création d'un isotope radioactif artificiel du phosphore, le phosphore 30 :
He2 4 + Al 13 27 => P 15 30 + n 0 1 (neutron) ?
Le phosphore 30 se transmute en silicium 30 par radioactivité B+ : P15 30 => Si 14 30 + e 1 0 (positif ou positron ou positon)
Pour cette découverte, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont obtenu le prix Nobel de chimie en 1935. On sait aujourd'hui créer des centaines d'atomes radioactifs artificiels pour de très nombreuses applications. On les fabrique à la demande, selon les besoins médicaux, scientifiques ou industriels. La radioactivité artificielle est régie par les mêmes lois que la radioactivité naturelle.
Les questions :
1a. Citer le nom des scientifiques qui ont découvert la radioactivité naturelle et qui ont reçu le prix Nobel de physique en 1903.
1b Qu'est-ce que la phosphorescence ?
2. D'après vos connaissances de seconde, indiquer la nature des rayons X ?
3. Les « rayons uraniques » sont-ils de même nature que les rayons X ? Justifier.
4. Quels sont les éléments susceptibles de produire de tels rayons ?
5. C'est Marie Curie qui inventa le mot de radioactivité. Que signifie-t-il ? Proposer un synonyme à ce terme.
6. Pourquoi la radioactivité est-elle qualifiée de naturelle ?
7. Une transformation radioactive est-elle une réaction chimique ? Justifier.
8. Citer le nom des scientifiques qui ont découvert la radioactivité artificielle.
9. Pourquoi la qualifie-t-on d'artificielle ?
10. Quel lien ont ces scientifiques avec Pierre et Marie Curie ?
11. Affecter à chaque équation nucléaire évoquée dans le texte, les termes suivants : désintégration, réaction nucléaire provoquée.
12. En utilisant vos connaissances de seconde, indiquer la signification des nombres que l?on trouve au niveau de la notation symbolique suivante : P 15 30 .
13. Donner la définition d'isotope.
14. Expliquer la notation n 0 1 pour le neutron et e 1 0 pour le positon.
15. Qu'appelle-t-on rayonnement ? Rayonnement B+ ? En déduire ce qu'est le rayonnement B- ?
16. En utilisant les équations nucléaires écrites dans le texte ci-contre, proposer deux lois de conservation que vérifie toute transformation nucléaire qu'il s'agisse de désintégration ou d'une réaction provoquée.
17. Ecrire les réactions successives de désintégration présentées dans le document désintégration de l'uranium, qui ont lieu à partir de l'uranium 238 jusqu'au radon 222.
___________________
***Topic remanié suite aux posts de l'activité***