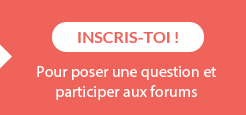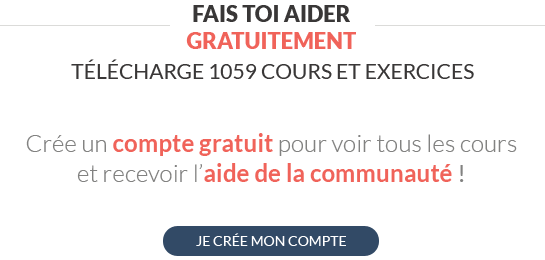Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Temperature définition/echelle
Bonjour,
La température caractérise l'agitation thermique. On peut comprendre intuivement que le produit PV à quantité de matière contstante est prortionnel à T la température, pour un gaz parfait.
On peut caractériser une température en utilisant donc le produit PV quand P tend vers 0 pour que la gaz se comporte comme un gaz parfait. Ceci permet de mesurer les températures de manière objective et universelle.
Pourquoi s'embêter avec des constantes ? Pourquoi définir le Kelvin à partir de cette définition mais en rajoutant des contsantes ?
Ce serait plus simple de juste définir une échelle en utilisant juste le produit PV pour la température. On aurait ainsi la loi des gaz parfait simplifiée : pv=nr. Au lieu de rajouter une constante.
Fin en réalité, aussi j'ai pas bien compris comment était défini le Kelvin. Dans mon cours on calcul le produit PV quand P tend vers 0 à la température du point triple de l'eau, et on attribe à cette valeur 273,15 K pour avoir une échelle centesimal. Mais pourquoi avoir besoin de se baser sur le point triple de l'eau ? Ok on peut ajouter des constantes pour l'échelle centesimal, mais pourquoi le point triple ?
Pouvez vous m'éclairez ?
Bpnjour,
D'où vient le Kelvin ?
Quand Mr Kelvin a "pensé" son échelle de mesure de température, il a fait correspondre l'absence totale d'agitation thermique au zéro de son échelle de mesure.
Il restait encore à définir à quoi correspondait une variation de température de 1K.
A cette époque, le degré Celcius était utilisé ... et Mr Kelvin a donc natrurellement choisi qu'une variation de température de 1°C correspondrait aussi à une variation de tempéraut-re de 1 K
Et voila.
Ceci étant fait, on peut mesurer les températures en Kelvin ... et il se fait alors que le point triple de l'eau se trouve à 273,16 K, ce n'est pas une valeur "attribuée", c'est simplement la mesure de la température en Kelvin de ce phénomène (point triple de l'eau).
Et puis les normes sont passées par là ... (on a pensé à l'envers).
On a défini le Kelvin comme la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau (H2O).
Ensuite "on" a pondu une autre définition (actuelle, enfin je pense) ... qui a voulu respecter la valeur donnée par la définition précédente, mais basée sur la constante de Boltzmann ...
On a alors maintenant : que 0 K = -273,15 °C (zéro absolu) ... et le point triple de l'eau est donc à la température de 0,01 °C
--------
Pour le reste, je ne suis pas du tout, PV = nRT permet de lier la pression, le volume et la température (absolue).
PV = nRT permet de lier la pression, le volume et la température absolue en Kelvin.
Si on avait défini une échelle de température comme étant égale au produit PV pour un gaz parfait de une mole, à une certaine température. Disons que cette unité est le abcd.
Alors on aurait eu PV = nT, T en abcd. Plus simple dcp ?
Et comment Kelvin a fait pour trouver ce zéro absolue ? Pour le degré celsus, c'est simple, on a du prendre un truc sensible aux variations de températures. Disons un tube en verre remplie d'un liquide sensible. Et quand on met une graduation au niveau du volume occupé quand l'eau boue et un seconde au niveau du volume occupé quand l' eau est glace. Mais avec le zéro absolu ? Comment on fait ?
Complément:
constante des gaz parfaits (= 8,314 411 J · mol-1 · K-1).
Toi tu veux redéfinir cette constante pour qu'elle soit égale à 1.
Pourquoi pas?
Mais cela n'a guère d'intérêt et mettrait plus de bazar un peu partout pour un "gain" plus que marginal.
A chacun son avis.
Bonjour
Assez d'accord avec tauste sur l'aspect historique. Expérimentalement, on peut partir des diagramme d'Amagat des gaz réels où on représente, pour une mole de gaz réel, les variations du produit PVm en fonction de P pour les faibles pressions (Vm : volume molaire) à température T fixe. L'expérience montre que, pour les faibles pressions et pour divers gaz, les courbes PVm=f(P) sont des droites ayant toutes la même ordonnée à l'origine. Sachant qu'il est possible de consirérer le gaz parfait comme le cas limite du gaz réel à pression tendant vers zéro, par définition de l'échelle Kelvin, on considère que cette ordonnée à l'origine est proportionnelle à T :
Reste à définir un cas particulier pour déterminer expérimentalement R : cela se fait en attribuer arbitrairement la valeur 273,16K à la température du point triple de l'eau. On définit ensuite l'échelle Celsius :
t(°C)=T(K)-273,15
Les valeurs 273,15 et 273,16 ont été ajustées de façon que les valeurs 0°C et 100°C correspondent respectivement à la température de solidification et à la température de vaporisation de l'eau sous pression normale.
Voila, très résumé, l'aspect historique, mais tout cela est un peu obsolète depuis le 20 mai 2019 : pour figer le système international d'unités vis à vis d'éventuels progrès dans les techniques de mesures, toutes les unités et pas seulement le mètre sont définis à partir de constantes auxquelles ont attribuent des valeurs exactes. Ainsi, le kelvin (k minuscule quand on parle de l'unité) est défini en attribuant une valeur exacte à la constante de Boltzman :
k=1,380649.10-23J/K
https://www.bipm.org/fr/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1
Bonjour tauste
Alors on aurait eu PV = nT, T en abcd. Plus simple dcp ?
Outre la simplicité, la définition d'une unité doit obéir à une autre contrainte : ne pas être en contradiction avec les habitudes des gens dans la vie courante. C'est le sens de la phrase de mon précédent message :"Les valeurs 273,15 et 273,16 ont été ajustées de façon que les valeurs 0°C et 100°C correspondent respectivement à la température de solidification et à la température de vaporisation de l'eau sous pression normale. " J'ai oublié de préciser dans mon précédent message que le résultat n'est qu'approximatif (approximation excellente ) pour 100°C. Je précise un peu mieux les choses ci-dessous.
Dans la vie courante, les gens, y compris souvent dans les laboratoires, utilisent des thermomètres gradués en °C. En fait, ces thermomètres utilisent l'échelle centigrade officiellement obsolète depuis très longtemps : la fabrication du thermomètre est très simple dans son principe ; c'est le thermomètre à alcool ou à mercure que tu connais : la division "0" correspond à la glace fondante sous pression normale ; la division 100 correspond à l'eau bouillante sous la pression normale puis on divise l'intervalle en 100 parties égales pour avoir les graduations en degrés centigrades. Les valeurs 273,15 et 273,16 ont été choisies de sorte que l'échelle Celsius et l'échelle centigrade coïncident exactement à 0°C et coïncident en excellente approximation pour l'eau en ébullition sous pression normale : 100°Centigrade=99,975°Celsius. Aux autres températures, l'écart reste toujours très faible de sorte qu'il est possible de considérer qu'un thermomètre à mercure ou à alcool gradué en °C indique la température en degrés Celsius même si son principe de fabrication le conduit à repérer les degrés centigrades.
mais pourquoi le point triple de l'eau?
C'est un cas très particulier : l'eau en ébullition est aussi en équilibre avec des glaçons à une température très particulière et une pression très particulière (611,3Pa). Cette situation est facile à reproduire en laboratoire spécialisé et a servi longtemps de situation "étalon" et, comme déjà dit, la définition de la température absolue nécessite de faire des mesures dans un cas particulier pour déterminer la constante R.
Comme déjà dit, tout cela est obsolète depuis le 20 mai 2019. La constante R a maintenant une valeur exacte puisque :
R=k.NA
avec :
k : constante de Boltzman : valeur exacte par définition du kelvin ;
NA : constante d'Avogadro : valeur exacte par définition de la mole (plus de référence aux douze grammes de carbone 12).
Je n'ai pas eu le temps de vous répondre sur le coup.
Merci pour vos messages, cette discussion rend tout ça plus clair pour moi.
Merci 
cette discussion rend tout ça plus clair pour moi.
Tant mieux !
Juste une précision pour ta culture personnelle : rigoureusement parlant, il n'y a jamais eu de "Monsieur" Kelvin mais un physicien thermodynamicien du XIXième siècle : Monsieur William Thomson qui, en raison de l'importance de ses travaux scientifiques, a été anobli en "Lord Kelvin".
Il travailla notamment avec Monsieur James Joule : la détente dite de "Joule et Thomson" est toujours au programme de thermodynamique niveau (bac+1).