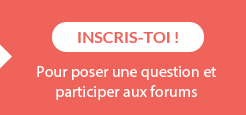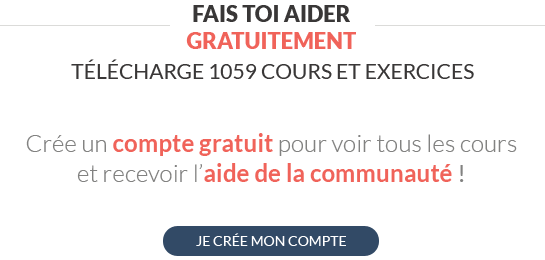Inscription / Connexion Nouveau Sujet
La Physique science exacte ou approchée ?
Bonjour
Un peu de philosophie.
J'ai lu dans un ouvrage de physique que celle ci était une science exacte. Pour moi c'est plutôt une science approchée. J'aurai aimé que l'auteur de ce livre argumenta son affirmation. Peut être que nous donnions aux mêmes mots des sens différents et que finalement nous aurions été d'accords.
Pour moi les mathématiques sont des sciences exactes puisque nous en fixons les règles.
Par contre la démarche du physicien est une succession sans fin d'observations de quantifications et de modélisations de l'univers qui nous entoure et dont nous ne maîtrisons pas les règles.
Un modèle est admis jusqu'à ce que d'autres conditions d'expérience, des mesures plus précises remettent ce modèle en question et qu'il en émerge un autre.
Si je dis que la physique est une science approchée, c'est parce que nous travaillons avec des modèles qui évolueront, qui seront peut être remplacés. Aujourd'hui ils nous suffisent mais ils ne sont pas, il ne seront jamais exacts.
Je pense que nos modèles s'affineront se perfectionneront sans cesse mais que l'ultime nature de l'univers nous sera à jamais inaccessible et c'est finalement très bien pour l'esprit humain qui dispose ainsi d'un espace de recherche infini. .
Alors quand pensez vous:
La physique science exacte ou science approchée ?
La question peut paraitre futile mais elle conditionne la manière dont l'enseignement de la physique devait être abordé.
Question de vocabulaire.
Les maths sont souvent classées dans les sciences "formelles".
La physique, la chimie et la biologie ne sont pas des sciences formelles mais sont généralement classées dans les "sciences exactes".
Je ne vais pas épiloguer sur le bien fondé ou non de cette appellation, vas plutôt voir sur les 2 liens que je te donne, on en parle un peu.
![]()
![]()
************
Coup classique, le vocabulaire "spécialisé" n'a pas toujours la même signification que celle du langage "commun", celui de monsieur tout le monde et tous les "spécialistes" n'utilisent pas non plus les mêmes définitions pour une même notion.
Cela entraîne forcément des malentendus...

Salut !
!
On parle aussi de sciences expérimentales. Effectivement tout ce que tu dis est vrai puisque la physique se base surtout sur des approximations, etc.
Néanmoins je ne suis pas sûre d'adhérer à ce que tu dis...
Oui car c'est une science basée sur les expérimentations... Si une expérience chamboule toute une théorie, tu changes la théorie...
Bonjour
Je remercie tout ceux qui ont participé et plus particulièrement J-P qui m'a donné des liens sur des informations détaillées.
Je pressentais que ce n 'était qu'une question de vocabulaire. Je suis rassuré car le qualificatif «exacte», que j 'admettrai désormais, ne remet pas en cause ma conception de la physique. Ce n'est qu'une question de vocabulaire.
J'aurais aimé que shadowmiko développa un peu les raisons pour lesquelles elle n'est pas sûre d'adhérer. Cela m'aurait certainement donné un autre éclairage sur la question.
Je m'interroge maintenant sur la manière dont nos jeunes têtes reçoivent un enseignement qui est exprimé avec un vocabulaire dont le sens peut être différent de celui qu'ils utilisent quotidiennement. Les malentendus qui en résultent peuvent être une des raisons du rejet de cette science par certains. Avant d'utiliser un mot devrons nous systématiquement le redéfinir ?
Al
Pour moi aucune science n'est approchée (maths/physique/géologie/biologie/chimie, ...). Elles évoluent selon nos progrès. On ne possède pas encore tous les outils qui nous permettent d'élaborer des théories infaillibles, donc on se "contente" de théorie très fiables. Dans qq années ce que j'apprend actuellement sera peut être révolu
Je n'ai pas trop le temps de développer désolé, la course à pied et les "excursions internet" faisant partis des rares temps de repos de la prépa.
Néanmoins je te remercie d'avoir posé une question si intéressante
Bonjour à tous,
Quelques sujets de réflexion ; peu de propositions de réponse.
Comme toujours pour ces questions il y a le risque d'être piégé par le vocabulaire. Il faudrait (les philosophes le tentent) passer un temps considérable à vérifier l'accord sur les définitions.
Les mathématiques sont-elles une science ? Les objets qu'elles manipulent sont des définitions. Après avoir posé des axiomes, l'application de certaines règles logiques permettent des démonstrations et l'énoncé de théorèmes. Et l'on continue ainsi si aucune contradiction n'apparaît.
La physique vise à une description et à une "compréhension" de la nature. Elle utilise, entre autres, l'observation, plus encore l'expérimentation, la modélisation mathématique...
J'aurais tendance à me méfier des termes "sciences exactes" mais je ne vois guère de difficulté à parler de "sciences expérimentales".
L'expérimentation dépend elle-même (entre autres...) de la mesure. Les progrès techniques qui permettent la diminution des incertitudes de mesure peuvent être à la source de la recherche de nouvelles théories dont les prévisions sont confirmées par l'expérimentation, aux inévitables incertitudes de mesure près...
_______________________
Je ne résiste pas à citer quelques passages d'un livre que j'aime beaucoup :
Jean-Marc Lévy-Leblond
Aux contraires
(page 35)
"Contrairement à l'opinion commune, la grande affaire de la science est moins la production de vérités absolues et universelles ou la reconnaissance d'erreurs rédhibitoires, que la délimitation des conditions de validité d'énoncés dont, pour le coup, le scientifique hésite quelque peu à les dire "vrais" ou "faux" sans qualifications. Pour qu'un résultat expérimental ou une loi théorique puissent être déjà pris en considération, pour qu'ils puissent ne fût-ce qu'être discutés comme scientifiques, ils doivent être présentés comme "vrai, si..." ou "faux, mais...". Les vérités de la science ne sont jamais nues. Et c'est l'énonciation, contraignante, des conditions, circonstances et hypothèses d'une assertion, qui seule lui donne sens et permet de l'accepter ou de la refuser. Ainsi, il est "vrai" que le Soleil tourne autour de la Terre, si le mouvement est décrit dans le référentiel de la Terre ; ou, réciproquement, il est "faux" que le Soleil tourne autour de la Terre, mais cette description est correcte d'un point de vue particulier...
Ce qui singularise la science dans le concert des modes de connaissance humains, est donc, à l'inverse des idées reçues, de renoncer à atteindre la vérité, ou plus exactement de faire de la vérité une notion purement relative, toujours subordonnée à celle de validité. Il n'est guère d'énoncé scientifique "vrai", aussi simple, direct, évident et ancien soit-il, qui ne se trouve un jour ébranlé et déstabilisé par sa mise en perspective. Le cadre qui assurait sa validité, jusque-là implicite, se trouve tôt ou tard dépassé et englobé dans un tableau plus large, où la "vérité" de l'énoncé initial est contredite hors des frontières de l'invisible domaine initial."
(...)
(page 43)
"La première véritable théorie physique, au sens moderne du terme, a sans nul doute été la mécanique newtonienne. Pour la première fois, en effet, un vaste ensemble de faits d'observation et d'expérience se trouvait transcendé et synthétisé en un formalisme mathématique cohérent, explicatif et prédictif. Les succès de la théorie, surtout dans le domaine astronomique, conduiront les physiciens de la première moitié du dix-neuvième siècle à lui accorder une confiance totale, jusque dans les nouveaux domaines de leurs investigations, notamment l'électromagnétisme. Il faudra attendre le début du vingtième siècle pour que les difficultés croissantes qu'avait rencontrées le paradigme newtonien conduisent à accepter son dépassement par une nouvelle conception, fondée sur la notion de champ et la relativité einsteinienne. Mais ce dépassement n'est pas un remplacement, et le rapport d'Einstein à Newton n'est nullement celui de la vérité à l'erreur. D'une part, pour considérer le point de vue einsteinien comme "vrai", sans autre qualification, il faudrait justement oublier les conditions de son apparition, contre la théorie newtonienne. La prudence élémentaire nous commande d'adopter désormais un point de vue moins dogmatique, et de tenir la théorie einsteinienne pour valable à titre provisoire. Mais surtout, c'est dans des conditions bien précises que les concepts newtoniens ont montré leurs limites : pour l'essentiel, lorsque l'on a dû considérer des phénomènes mettant en jeu des vitesses égales ou comparables à celle de la lumière (dont, au premier chef, les phénomènes lumineux eux-mêmes). A contrario nous savons donc désormais que lorsque ces conditions ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire pour des vitesses faibles devant celle de la lumière, la théorie newtonienne garde sa validité. Ainsi donc, la mise en évidence des limites de la théorie, loin de la fragiliser, la conforte - à l'intérieur de son domaine de validité, désormais reconnu. C'est là le point crucial."
(...)
(page 44)
"Une théorie jusqu'ici toujours confirmée s'expose en permanence à buter sur l'imprévisible fait expérimental qui signalera les limites encore inconnues de sa portée. Par contre, une théorie aux frontières repérées n'en est que plus assurée à l'intérieur de son domaine, où l'on peut même estimer avec précision le degré de son adéquation à la réalité. Ainsi, la relativité einsteinienne n'a pour l'instant montré nulle défaillance, et nous sommes donc quotidiennement à la merci des erreurs que nous commettrons en l'appliquant à des phénomènes qui échapperaient à sa juridiction sans que nous le sachions par avance ; par contre, la relativité galiléenne, dont nous savons qu'elle ne vaut, et approximativement, que pour des vitesses très inférieures à celle de la lumière, bénéficie, du coup, de notre confiance d'autant plus fondée que nous pouvons évaluer et contrôler le degré relatif de son adéquation. Car c'est justement l'un des privilèges de la physique, en tant qu'elle est mathématisée, que de pouvoir évaluer quantitativement la fiabilité de ses théories - une fois qu'elles ont rencontré leurs limites et ont été dépassées par une théorie plus performante."
____________________
La très bonne question posée par Al_affut est celle de l'enseignement.
Je ne sais pas bien comment il faut s'y prendre. Encore que des expérimentations récentes me semblent très prometteuses. 
![]()
Mais je finis par avoir quelques idées sur les mauvaises manières. En caricaturant : il y a des "lois", sans doute tombées du ciel ; elles se traduisent par des "formules" à savoir par cœur sans chercher à comprendre ; l'exercice de physique devient ainsi un exercice de mathématiques appliquées, pas trop difficile à corriger car on y recherchera tout d'abord l'erreur de calcul. Bon... je suis mauvaise langue.
Désolé... c'est très long !

Je ne te trouve pas si mauvaise langue que ça C'est quand même frustrant de ne faire de la "vraie" physique qu'en sup'... On n'apprend pas vraiment à l'élève à raisonner...
C'est quand même frustrant de ne faire de la "vraie" physique qu'en sup'... On n'apprend pas vraiment à l'élève à raisonner...
Bonjour
Je remercie Coll pour sa contribution. J'ai lu et relu les extraits du livre de Lévy-Leblond . Le contenu en est très dense il n'est pas possible de le lire en diagonale. Cela m'a donné l'envie de me procurer l'ouvrage ainsi que d'autres du même auteur.
L'extrait de la page 35 est pour moi du vécu. J'ai très souvent dans ma vie professionnelle eu à répondre à des questions en relation avec la physique dont les auteurs n'attendaient très souvent pour réponse que "oui" ou "non" . Aucune de ces deux réponses n'étaient pour moi satisfaisantes (au grand dam de mes interlocuteurs)si elles n'étaient pas accompagnées de conditions de validations.
En ce qui concerne le dernier paragraphe relatif aux formules tombées du ciel je ne peux qu'abonder dans ton sens. Manque de moyens, manque de temps, Il n'y aura qu'un petit nombre d'élèves qui seront capables d'aller seul au delà de la formulation. Avec une formule tombée du ciel un élève peut penser à tord que la formulation précède le phénomène ce qui lui donne un caractère intangible.
Merci pour les liens sur les expérimentations sur de nouvelles méthodes d'enseignements.
Al
Je suis heureux que ces extraits du livre de Jean-Marc Lévy-Leblond t'aient donné envie de lire cet auteur.
Aux contraires est certainement son livre le plus abouti. Il nécessite un effort de lecture mais on est payé de retour. Quel régal ! Il n'apparaît pas ici que l'auteur (à l'écrit comme à l'oral) est doué d'humour, ce qui facilite les choses.
Il est l'un de ces grands professeurs de physique (lui est maintenant à la retraite) qui, dans la grande tradition, ne veulent pas se couper de la réflexion philosophique sur le sens de la physique et du travail du physicien.
Il n'est pas le seul et, heureusement, il y a de la relève dans les nouvelles générations !
Bonnes lectures !